Lien vers les lectures du dimanche 9 février
Homélie du 5e dimanche du temps ordinaire
Nous avons ici deux rencontres de Dieu avec des hommes appelés à être des messagers de Dieu, des envoyés.
La première rencontre est très impressionnante : Isaïe, le prophète, voit le Seigneur lui apparaître dans une vision extraordinaire. Le Seigneur siégeait sur un trône très élevé, entouré de milliers d’anges proclamant sa sainteté : « Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur de l’univers… » Ce sont les mêmes paroles que nous prononçons au cours de la liturgie, juste avant que le Seigneur descende sur ce trône qu’est l’autel de nos églises à travers le pain et le vin consacrés.
À la messe, nous faisons ce que font les anges. Nous nous réunissons pour proclamer la sainteté de Dieu. Invisiblement, ces mêmes anges, qui se sont montrés au prophète Isaïe, sont avec nous à chaque eucharistie. Au cours de la messe, le monde visible et invisible se rejoignent. Il n’y a plus de différence entre l’Église du ciel et l’Église de la terre.
Pourtant, si, il y a une différence. Au ciel se trouvent l’Église triomphante, les anges et les saints, ceux qui sont morts dans l’amour de Dieu. Sur la terre, il y a l’Église militante, les hommes et les femmes appelés à la sainteté, appelés à la perfection. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait… »
Or, nous voyons bien que nous sommes loin du compte !
C’est ce que constate Isaïe lui-même : « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures ; j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »
L’impureté s’oppose à ce qui est saint. En réalité, seul Dieu est saint au sens strict. Et si nous sommes saints, c’est uniquement parce que Dieu nous rend saints.
Mais comment Dieu nous rend-il saints ? Voyons ce qui arrive à Isaïe. C’est un peu mystérieux. Un séraphin, c’est-à-dire un ange, vole vers lui, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pincettes sur l’autel. Il s’approche de la bouche d’Isaïe et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »
Le charbon, dans la liturgie, sert à brûler l’encens. L’encens est le symbole de notre prière qui monte vers Dieu : « Que ma prière, Seigneur, s’élève comme l’encens devant toi et mes mains comme l’offrande du soir. »
C’est le Seigneur lui-même qui, en venant dans notre cœur, nous purifie et nous rend capables de répondre à son appel.
La deuxième rencontre se fait beaucoup plus simplement. Cette fois, ce n’est pas une vision. Dieu, dans la personne de Jésus, vient lui-même rencontrer les hommes dans leur vie de tous les jours. Il monte dans leurs barques de pêcheurs. Il vient les rejoindre là où ils en sont et il les enseigne.
Ces pêcheurs ont cependant quelques motifs d’inquiétude. Ils ont pêché toute la nuit et ils n’ont rien pris : pas un poisson.
Malgré cela, Jésus leur donne l’ordre de jeter à nouveau leurs filets, mais à un autre endroit : « Avance au large… » C’est-à-dire quitte la fausse sécurité du rivage, accepte d’avoir confiance dans le Seigneur et dans sa parole plutôt qu’en toi-même.
L’obéissance est la plus grande des qualités pour un chrétien. Il faut toujours obéir à la parole de Dieu, il faut toujours obéir à Jésus, qui est la Parole de Dieu.
C’est ce que fit Simon avec ses compagnons, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchirèrent.
Simon a alors la même réaction qu’Isaïe devant la vision de Dieu, car il reconnaît dans ce miracle la présence de Dieu. Mais Jésus lui dit : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et, laissant tout, ils le suivirent.
Pour suivre le Christ, nous devons aussi laisser certaines choses de côté si elles nous empêchent de le suivre. Et d’abord, le sentiment de notre indignité.
Si nous croyons qu’il faut être irréprochable pour répondre à l’appel de Dieu, Jésus nous rassure : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. »
Simon, André, Jacques et Jean n’étaient pas des hommes exceptionnels. Ils n’étaient ni riches, ni docteurs de la loi, ni hommes de pouvoir. C’étaient de simples pêcheurs.
Et pourtant, ce sont eux que Jésus a choisis. Nous devons être certains que, nous aussi, nous sommes choisis et appelés.
Nous devons laisser le seul Saint nous rendre saints. Il nous sanctifie par sa Parole, si nous la recevons avec foi et la prière. Il nous sanctifie par l’Eucharistie, qui est comme un charbon ardent, comme un feu que le Seigneur met dans nos cœurs pour nous purifier.
Nous pouvons alors devenir ses messagers, ses envoyés.
Dieu, ce n’est pas comme la poste : il n’est jamais en grève. Mais son courrier, ne peut arriver sur la terre et être connu des hommes sans messager.
Voulez-vous être ses messagers ?
Comme Isaïe, comme les premiers disciples, répondons : « Moi, je serai ton messager : envoie-moi. Je serai ton envoyé !”
Homélie de la messe de la santé :
Nous le savons, mais nous l’oublions trop souvent : le Seigneur n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous, en effet, vivent pour et par Lui.
En ce dimanche où nous célébrons la messe de la santé, et prions spécialement pour tous les malades et pour ceux qui se dévouent à leur service. C’est aussi l’occasion de parler du sacrement de l’onction des malades, plus connu sous le nom d’extrême-onction. Ce sacrement fut longtemps appelé ainsi parce qu’il était souvent administré au moment ultime de la vie, lorsque la personne était à ses dernières extrémités.
On liait ensemble — et l’usage demeure — la confession, l’extrême-onction (où le prêtre oint le front et les mains du malade et le bénit) et le viatique, pain de force pour le dernier voyage. Ainsi, muni des sacrements de l’Église, le chrétien pouvait remettre son âme à la miséricorde de Dieu. Au point que, pour beaucoup, appeler le prêtre pour ce sacrement signifiait une mort prochaine.
Or, ce sacrement n’est pas réservé aux mourants. Il est une aide offerte aux malades pour croire, aimer, espérer : il est donné pour vivre. Le Seigneur, en effet, n’est pas le Dieu des morts ni des mourants, mais des vivants, de ceux qui vivent par Lui et pour Lui.
Comme le dit le Catéchisme de l’Église catholique :
« La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l’état de maladie. »
Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu, fortifie contre la tentation du Malin, la tentation du découragement et du désespoi
L’homme est un tout : il est à la fois âme et corps. Comme le disait saint Grégoire Palamas au XIVᵉ siècle :
« Nous n’appliquons pas le nom d’homme séparément à l’âme et au corps, mais aux deux ensemble, car l’homme entier fut créé à l’image de Dieu. »
De même, saint Irénée nous enseigne que le Christ est le Sauveur de l’âme et du corps :
« S’Il ne sauve pas aussi notre corps, Il ne nous sauverait pas du tout, car on n’a jamais vu un homme sans corps. »
C’est pourquoi le Christ guérissait à la fois les maladies du corps et celles de l’âme, et les Évangiles sont remplis de récits de guérisons : paralysés, aveugles, sourds, muets, lépreux, épileptiques…
Cette onction, les apôtres l’ont prolongée :
« Les disciples chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades et les guérissaient. » (Marc 6,13)
Et aujourd’hui encore, le Seigneur continue cette œuvre de guérison dans son Église, par son Esprit Saint, à travers le sacrement de l’onction des malades.
Ce sacrement peut être reçu par toute personne malade, y compris pour des maladies psychologiques, et il est toujours célébré avec l’espérance de la guérison.
C’est donc à tort qu’on l’a longtemps appelé extrême-onction, comme s’il s’agissait d’un sacrement administré une seule fois, et uniquement aux derniers instants de la vie. Il n’en est rien.
L’institution de ce sacrement est d’ailleurs clairement relatée dans l’Épître de saint Jacques :
« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les prêtres de l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le guérira. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis. » (Jacques 5,14-15)
Il n’y a pas de frontière nette entre les maux du corps et ceux de l’âme. C’est pourquoi, tout au long de l’office de l’onction, on prie à la fois pour la guérison physique et pour le pardon des péchés du malade.
Mais cette guérison est demandée dans le cadre du salut et non pas comme une fin en soi. La véritable guérison consiste à se tourner vers le Christ et à pouvoir dire :
« Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » (Galates 2,20)
Dans l’Évangile, les verbes « guérir » et « sauver » se disent de la même manière en grec. Cela signifie que la guérison est le relèvement de l’homme tout entier, corps, âme et esprit, tourné vers Dieu.
Pourquoi faut-il un relèvement ? Parce qu’il y a eu chute.
La maladie, la mort, la vieillesse sont des conséquences du péché : elles ne sont pas naturelles.
Dans le paradis originel, l’homme vivait en communion avec Dieu, dans une plénitude de joie et de contemplation. Il n’y avait ni tristesse, ni douleur, ni souci, ni maladie.
Saint Augustin disait ainsi :
« L’homme n’avait à craindre aucune maladie intérieure. Dans sa chair : une parfaite santé. Dans son âme : une parfaite sérénité. »
Cet état originel, Jésus est venu le restaurer.
En araméen, Jésus signifie « Dieu sauve ».
En grec, Jésus signifie aussi « Dieu guérit ».
Il sauve en effet en guérissant.
Alors oui, notre Dieu est bien le Dieu des vivants et non des morts, et c’est pour Lui et par Lui que nous vivons.
Père Gabriel Ferone
Retrouvez les homélies du père Gabriel et du père Bertrand dans la rubrique « Messes et célébrations » / « Homélies des pères Gabriel et Bertrand » de ce site
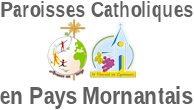
Cet article comporte 0 commentaires