Lien vers les lectures du dimanche 16 février
Homélie du père Bertrand
Le regard de Dieu
Jésus nous donne le point de vue de Dieu, et ce qui sera la charte de la nouvelle communauté qu’il vient tout juste de bâtir. Comme d’habitude, vous êtes allés voir ce qui se trouvait avant ce que nous lisons aujourd’hui. Vous avez trouvé l’appel des douze. Nous apprenons maintenant quel est leur point de vue sur les fils des hommes.
Heureux les pauvres, ils sont du côté de Dieu, heureux les affamés, ils sont du côté de Dieu, heureux ceux qui pleurent, ils sont du côté de Dieu. Heureux les haïs, les exclus, les insultés, ils sont du côté de Dieu.
Être du côté de Dieu signifie être aussi du côté des fils et filles des hommes.
Visitant les lieux d’accueil de la fondation Emaüs jeudi soir, pour constater à quoi va servir l’argent récolté par notre dernière action de Carême, j’étais malheureux d’être riche. Je pleurai aussi sur la société qui refuse de donner à chacun ce à quoi il a droit. Pour les plus pauvres, il faut arracher au riche, comme si on le dépouillait de sa chaire même.
Du coup, je me trouve du côté des haïs, des exclus et des insultés, les pauvres qui ne sont pas reconnus comme dignes et utiles. Bienheureux je suis.
Père Bertrand Carron
Homélie du père Gabriel
Le « je crois en Dieu » de Nicée Constantinople
La célébration cette année du 1700e anniversaire du Concile de Nicée me donne l’occasion de parler de ce credo de notre foi, qu’on appelle aussi symbole, et de m’écarter un peu des lectures de ce jour.
Le súmbolon est un mot d’origine grecque qui désignait, dans le monde antique, un objet coupé en deux (comme un tesson de poterie), dont chaque moitié était gardée par une personne différente. Lorsqu’on réunissait les deux parties, elles s’assemblaient parfaitement, servant ainsi de signe de reconnaissance ou de pacte.
De même, les chrétiens catholiques, pour confirmer que, loin des doctrines hérétiques, ils professaient bien la même foi des Apôtres dans le Christ, récitaient ensemble, comme nous le faisons chaque dimanche, la même « profession de foi », appelée, pour cette raison, un « symbole », c’est-à-dire un signe d’unité. C’est ainsi que le premier concile tenu à Nicée, en 325, a promulgué un « symbole » de la foi catholique. Ce Symbole de Nicée fut complété en 381, à Constantinople, d’où l’expression « Symbole de Nicée-Constantinople ».
La plupart des grands Conciles furent convoqués en raison d’hérésies qui déchiraient l’Église catholique. Pour ce qui est du Concile de Nicée, l’enjeu, à l’époque, était essentiellement la pleine reconnaissance à la fois de la divinité de Jésus et de sa véritable humanité.
Les premières attaques que dut subir la foi de l’Église vinrent du côté de ceux qui niaient que Jésus soit vraiment un homme comme nous. Partant de considérations philosophiques, ils jugeaient indigne d’une personne divine de devenir vraiment homme. C’était un abaissement de la divinité inconcevable ! « Dieu est Dieu », pensaient-ils. Il est éternel. Comment entrerait-il dans le temps ? Il est tout-puissant. Comment épouserait-il la fragilité de la condition humaine ? Il est immortel. Comment serait-il exposé à la mort ? Ils jugeaient donc que l’humanité de Jésus n’était qu’un vêtement superficiel, une apparence extérieure, non la réalité.
C’est pour cela que le Symbole de Nicée insiste si fortement sur l’humanité de Jésus. Il est vraiment « descendu du ciel, a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme, fut crucifié, souffrit sa passion et fut mis au tombeau ». Il est réellement entré dans l’histoire humaine sous Ponce Pilate. Il est réellement devenu homme parmi les hommes. Saint Ignace d’Antioche, deux siècles plus tôt, ne disait pas autre chose : « Soyez sourds quand on vous parle d’autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort sous les regards du ciel, de la terre et des enfers ; qui est aussi véritablement ressuscité d’entre les morts » (Lettre aux Tralliens, 9:1-2).
Les autres attaques vinrent du camp opposé, à savoir de ceux qui jugeaient que Jésus n’était pas véritablement Dieu. Il était une créature, semblable aux autres créatures. Une créature d’une particulière noblesse certes, « adoptée » par Dieu comme son porte-parole. Pour ces hérétiques du nom d’ariens, car ils tenaient leur doctrine d’un certain Arius, Jésus n’aurait pas existé de toute éternité, il aurait été créé par le Père. C’est ce que disent d’ailleurs aujourd’hui les musulmans, qui sont les descendants spirituels de cette hérésie: « Oui, il en est de Jésus comme d’Adam auprès de Dieu : Dieu l’a créé de terre, puis il lui a dit : “Sois”, et il est » (Sourate 3, 59). Dans l’İslam Jésus est un prophète qui accompli des miracles comme un sorte de super homme mais il n’est pas Dieu.
Alors que presque toute l’Église avait sombré dans l’hérésie arienne, surtout en Orient, se dressa heureusement saint Athanase d’Alexandrie. Comme d’autres évêques fidèles à la foi catholique, il subit la persécution. Il fut même cinq fois chassé de son évêché, mais y revint chaque fois, fidèle à la foi en Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C’est lui qui, habité par l’Esprit Saint, inspira le texte du Symbole de Nicée, proclamant avec insistance la vraie divinité du « Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles…
« Engendré et non pas créé », c’est-à-dire engendré de toute éternité de Dieu et en Dieu !
Pour exprimer l’égalité de dignité entre le Père et le Fils, le Concile de Nicée utilisa un mot grec un peu difficile à comprendre, comme le mystère auquel il renvoie : « homoousion tô Patri » ; en français, « consubstantiel au Père ». Ce qui souligne que le Père et le Fils ont la même essence, partagent la même réalité.
Dans les décennies qui suivirent le Concile de Nicée, des disputes analogues surgirent concernant cette fois la divinité de l’Esprit Saint. Certains prétendaient qu’il n’était pas vraiment Dieu. Au maximum, ils le reconnaissaient comme un souffle anonyme porteur d’énergie divine, présent de manière diffuse dans le monde. C’est contre eux que le Concile de Constantinople, qui eut lieu en 381, ajouta quelques mots au Symbole de Nicée, en précisant de l’Esprit Saint, que celui-ci est vraiment « Seigneur », c’est-à-dire « Dieu » ; qu’il n’est pas seulement un souffle vital anonyme, mais « celui qui donne la vie ». Et, de même que le Fils est engendré par le Père de toute éternité, ainsi l’Esprit « procède » du Père depuis toujours.
« Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Et c’est bien lui, en personne, qui « a parlé par les prophètes ».
Le reste du « Credo » développe le mystère pascal de Jésus et le cœur de la vie de l’Église. Après avoir évoqué la passion, la mort et la mise au tombeau, il affirme ce qui est le centre de la foi chrétienne, à savoir la résurrection du Christ, sans laquelle, comme nous dit saint Paul, notre foi est vaine ! « Jésus-Christ ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, il monta au ciel et siège désormais à la droite du Père ». Et c’est de là qu’il reviendra à la fin des temps.
Le Symbole de Nicée parle aussi de l’Église : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique ».
Une, malgré sa diversité et ses divisions, parce qu’elle a le Christ comme Tête, faisant l’unité du corps tout entier. Même composée des pécheurs que nous sommes, elle est sainte, parce que Jésus la purifie sans cesse dans son sang. Elle est catholique parce qu’elle est universelle, n’appartient à aucune nation particulière et est ainsi la plus belle « multinationale » qui soit, celle de la foi, de l’espérance et de la charité.
Elle est apostolique parce qu’elle repose sur le fondement solide des Apôtres et de leur enseignement.
Le Symbole s’achève par le rappel de notre baptême qui nous libère de nos péchés et nous fait vivre de la vie nouvelle du Ressuscité : « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ».
Tant de richesses en si peu de mots ! Disons donc ce Symbole de notre foi de tout cœur, lorsque nous avons l’ocasion de le dire, car c’est un véritable trésor, commun à tous les chrétiens du monde entier.
Père Gabriel Ferone
Retrouvez les homélies du père Gabriel et du père Bertrand dans la rubrique « Messes et célébrations » / « Homélies des pères Gabriel et Bertrand » de ce site
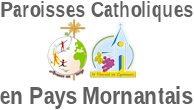
Apprécié l’homélie du Père Bertrand